La Charte de l’environnement, 20 ans après : bilan et perspectives
Intégrée dans le bloc constitutionnel français le 1er mars 2005, la Charte de l’environnement consacre, notamment, un nouveau droit individuel : celui de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ». Où en est-on vingt ans après ?
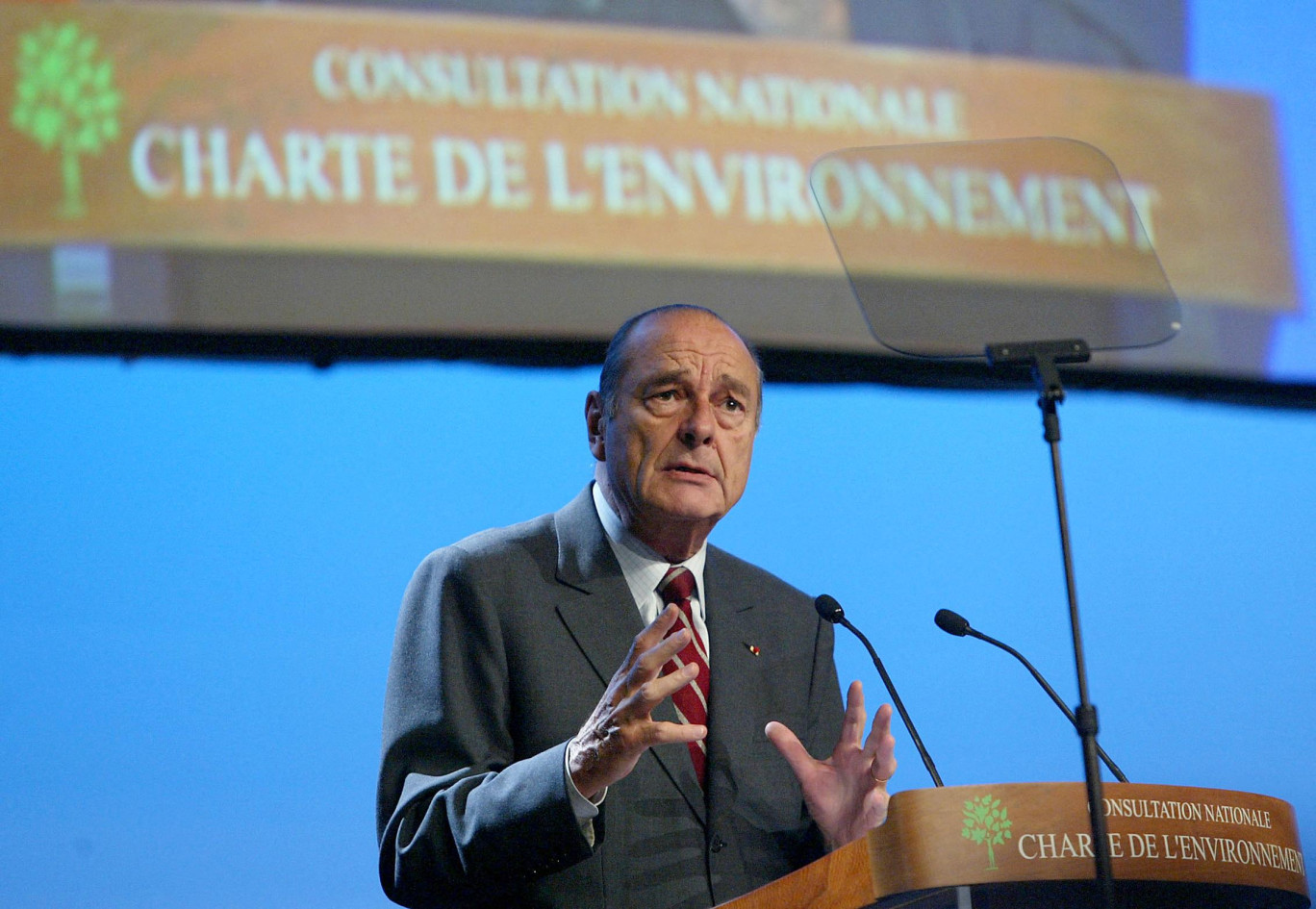
Quel
bilan peut-on tirer aujourd’hui de l’introduction de la Charte de
l’environnement dans la Constitution française ? Le préambule
et les dix articles de la Charte ont introduit trois grands principes
à valeur constitutionnelle : le principe de prévention, le principe
de précaution et le principe
pollueur-payeur. Le Conseil constitutionnel a, depuis,
progressivement précisé la portée de ces principes. La Charte
consacre également à chacun le « droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé » et
fait du « développement durable » un
objectif des politiques publiques en France. Ces nouveaux droits
s’accompagnent aussi de devoirs : chacun doit participer à la
préservation et à l’amélioration de l’environnement, prévenir
ou limiter les conséquences des atteintes qu’il peut porter à
l’environnement et contribuer à leur réparation.
Articulation
entre la Code et la Charte de l’environnement
« C’est
une charte très longue, un peu bavarde, mais d’application assez
pratique », a souligné
Philippe Billet, professeur de droit public et directeur de
l’Institut de droit de l’environnement de Lyon, lors d’une
table ronde organisée le 26 mars, au Sénat par la commission de
l’Aménagement du territoire et du Développement durable, à
l’occasion du 20e anniversaire de la Charte de
l’environnement. « Pour les juristes, la difficulté, au
départ, a été l’articulation entre les principes à valeur
législative du Code de l’environnement et les principes à valeur
constitutionnelle de la Charte ». Comme pour le principe
pollueur-payeur, par exemple, consacré à l’article L.
110-1 du Code de l’environnement et à l’article 4 de la Charte
de l’environnement.
Quel
impact pour les collectivités territoriales ?
Comment
les collectivités territoriales se sont-elles emparées des
principes énoncés par la Charte et, notamment de l’obligation,
prévue à l’article 6, de promouvoir le développement durable par
les politiques publiques ? « Je ne crois pas que les
collectivités territoriales se soient senties contraintes par la
Charte parce qu’elle n’est pas d’applicabilité directe sur
leurs décisions. La Charte s’applique souvent aux collectivités
dans un contexte de contestations des décisions qu’elles ont
prises – lorsque les requérants argumentent avec les principes de
la Charte. Je pense que la Charte n’a pas apporté grand-chose de
ce point de vue-là », a répondu le professeur de droit.
Dans
le contexte budgétaire actuel, « j’imagine qu’en ce
moment il est compliqué pour les collectivités territoriales de
trouver des moyens pour mener des politiques environnementales au
niveau local », a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet,
rapporteure du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée
nationale en 2004, et ministre de l’Écologie de novembre 2010
à février 2012. « Moi j’aimais beaucoup les
appels à projets du Grenelle de l’environnement » car
« c’est une façon de faire levier sur la bonne volonté
et le désir de faire d’un territoire, de donner un coup de pouce,
sans s’engager dans des politiques nationales transversales dont
nous n’avons plus les moyens. »
« Il
ne faut surtout pas rouvrir la Charte à la discussion »
Les
considérants de la Charte restent-ils toujours valables 20
ans après ? Des évolutions sont-elles possibles et souhaitables
aujourd’hui ? « On peut trouver que cela ne va pas assez
loin, on peut être irrité par la manière dont cela est mis en
œuvre, on peut trouver que les tribunaux font des choses étranges…»,
mais « je ne crois pas qu’il faille faire évoluer le
texte », a répondu l’ancienne ministre. « Je
pense en revanche qu’il faut faire évoluer nos politiques et que
l’on a [actuellement]
un moment historique autour de la sécurité énergétique et la
résilience. »
Selon
le professeur Philippe Billet, « il ne faut surtout pas
rouvrir la Charte à la discussion. Laissons le principe de
précaution, qui est très attaqué, tel qu’il est parce que ce
serait la porte ouverte à beaucoup d’autres choses. Je pense que
le préambule – même s’il n’est pas très bien écrit, même
s’il est assez substantiel – permet d’avoir des bonnes
ouvertures d’interprétation par le Conseil constitutionnel. »
Ceci dit, « il manquerait peut-être la bonne saisine au bon
moment du Conseil constitutionnel pour aller encore un peu
plus loin et reconnaître un principe de dignité de l’homme
à vivre dans un environnement sain – et pas seulement le droit de
vivre dans un environnement sain. »
20 ans après, « l’étonnante modernité de la Charte »
« Sur la question de savoir si la Charte a épuisé ses effets, je suis persuadé du contraire », a déclaré le sénateur Jean-François Longeot, (Doubs, Union centriste), président de la commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable. « À l’échelle du temps constitutionnel, vingt ans est une temporalité assez courte. L’urgence environnementale et climatique de plus en plus saillante conduira certainement à donner un nouvel élan à la portée de la Charte. De quelle façon et avec quelle invocabilité par le justiciable ? L’avenir nous le dira. »
« La
Charte, à mes yeux, est un pont tendu entre nous et les générations
à venir en rappelant que nous ne devons pas compromettre la capacité
des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs
propres besoins. En cela, la Charte de l’Environnement n’a rien
perdu de son étonnante modernité, et nous ne pouvons que nous
féliciter de la fécondité des principes qu’elle articule et de
la malléabilité juridique qui la caractérise », a conclut le
sénateur.










